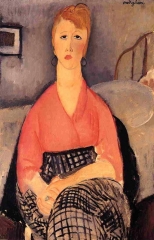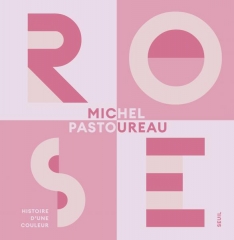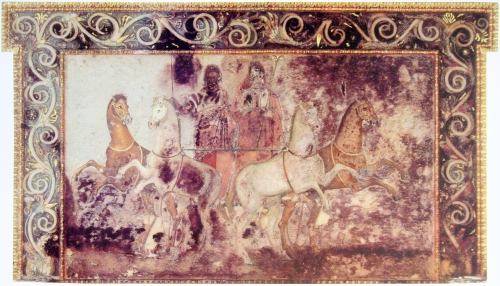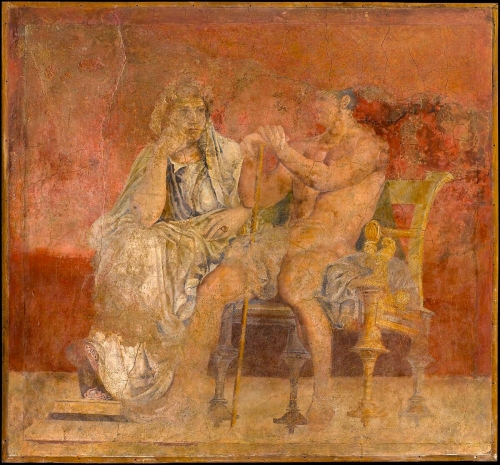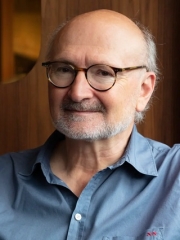Le bandeau « Prix Victor Rossel 2024 » m’a encouragée à lire Guerre et pluie de Velibor Čolić. Né en 1964 en Bosnie (alors Yougoslavie), il s’est réfugié en France en 1992 et vit actuellement en Belgique. Publié depuis 1993, il écrit directement en français depuis 2008. La guerre de Bosnie sous-tend une grande part de son œuvre. Ce roman a remporté d’autres prix littéraires.
« La maladie » (Bruxelles, 2021/2023), première partie, commence en juin par un jour de lumière : « La lumière du jour frappe la rue vide avec une force folle, se brise et rebondit en centaines de petits fragments qui vont mourir dans un parc voisin, pour s’y transformer en chlorophylle. Cette lumière est l’âme de toute chose. Et ces fragments sont sûrement les petits anges dont parlent les livres saints. »
Tandis que le monde entier se préoccupe d’un virus potentiellement mortel, il se sent « exotique, avec [sa] maladie inexplicable » qui le fait maigrir et saigner : « Un millier de lames de rasoir traversent ma langue. Je suis un globule blanc, je suis une longue formule médicale, je ne suis plus un homme, je suis un diagnostic. Pemphigus vulgaris. » A cause de cette maladie de peau très rare, tout le fait souffrir, la chaleur, les vêtements, le moindre contact. A cinquante-sept ans, elle réduit sa vie à l’instant présent.
Avant de prendre le métro pour se rendre à la clinique, il met du fond de teint, des lunettes noires ; les gens prennent peur en le voyant et le laissent assis seul, penché vers son téléphone. A la clinique où il cherche sa « route » dans le labyrinthe des couloirs, une biopsie révèle cette rare maladie auto-immune : « La maladie ressemble à la guerre, c’est une violence brutale et injuste. Au moment où elle nous arrive, curieusement, le monde qui nous entoure devient plus clair. » Les examens, l’attente, réveillent les souvenirs de la « sale guerre » à laquelle il a pris part malgré lui.
« Je suis le seul patient de l’hôpital qui écrit. » Dans son carnet, il note tout : les patients qu’il côtoie pendant son immunothérapie par intraveineuse, les femmes dont il se souvient. Sa maladie « n’est rien d’autre que la guerre qui sort de vous », lui dit un réflexologue. Ce qu’il préfère entendre, dans ses écouteurs, c’est la pluie qui tombe, des enregistrements sonores de la pluie sur toute la planète. Il en choisit un, s’installe confortablement et ouvre la porte des souvenirs.
Les seuls Belges qu’il fréquente sont des médecins, à cette période où la solitude protège du virus. Ecriture, littérature, jazz, glaces, films, café, thés divers – pas d’alcool, c’est fini pour lui. Il pense à la mort, au premier cadavre vu à douze ans, celui de sa grand-mère. Puis à un camarade de classe, noyé dans la rivière. A son premier grand amour, à quatorze ans. A son expulsion de l’équipe de football, vu sa maladresse, ce qui lui a fait découvrir « le temps libre » : en Yougoslavie, « nous sommes tous une classe moyenne socialiste heureuse ».
La partie centrale, « Le soldat » (Bosnie-Herzégovine, hiver-printemps 1992), est la plus longue du roman. A la radio régionale de sa ville natale, il est « animateur-journaliste-producteur », « planque idéale » pour cet amateur de jazz. Son amie Milena lui annonce qu’elle déménage à Belgrade avec ses parents – « Les Serbes, les Croates et les Bosniaques ont commencé une guerre, mesquine, laide et sale. » D’abord il vit presque normalement, il est devenu « un habitué du célèbre café Globus. Le paradis des alcooliques, le moins cher dans cette partie de la ville. » Il se soûle puis montre aux autres ce qu’il a écrit, jusqu’au premier bombardement.
Le voilà fantassin avec son carnet noir et une kalachnikov, dans la boue des tranchées, à vingt-sept ans. Ni héros, ni patriote, « juste un garçon terrorisé ». Par groupes de quatre, ils marchent, fument, cherchent de l’alcool. Dans la tête, les vers de Thomas Campbell : « Nos clairons ont sonné la trêve, car le nuage de la nuit s'est abaissé, / Et les étoiles sentinelles montent la garde dans le ciel, / Et des milliers sont tombés sur le sol, accablés, / Les fatigués pour dormir et les blessés pour mourir. » Ce dernier vers, cité en épigraphe, reviendra quelques fois.
« La guerre est une beuverie macabre. » Il boit « pour tenir huit heures dans les tranchées », sinon il dort. Son journal et l’alcool l’aident à survivre, il écrit ce que la guerre fait aux hommes, aux animaux, des scènes horribles. Corps puants, morts, blessés, explosion, hôpital, retour aux tranchées, « jusqu’au cou dans la boue et la merde ». Tentation du suicide. Défonce. Dévastations dues aux bombardements. « J’observe cette triste anatomie de la guerre avec une curiosité morbide. » Inventaire des destructions. « Je pense que si je survis, il faudra que j’écrive sur cette putain de guerre. » Déserter devient une obsession. Ce sera le sujet de la dernière partie : « Le déserteur » (France, été-automne 1992).
Dès les premières pages, Guerre et pluie fait entendre une voix d’écrivain : réaliste et ironique, observateur et désabusé, capable de poésie comme d’autodérision. « Un grand roman contre la guerre et son carnaval grotesque d’inhumanités » (Le Temps).